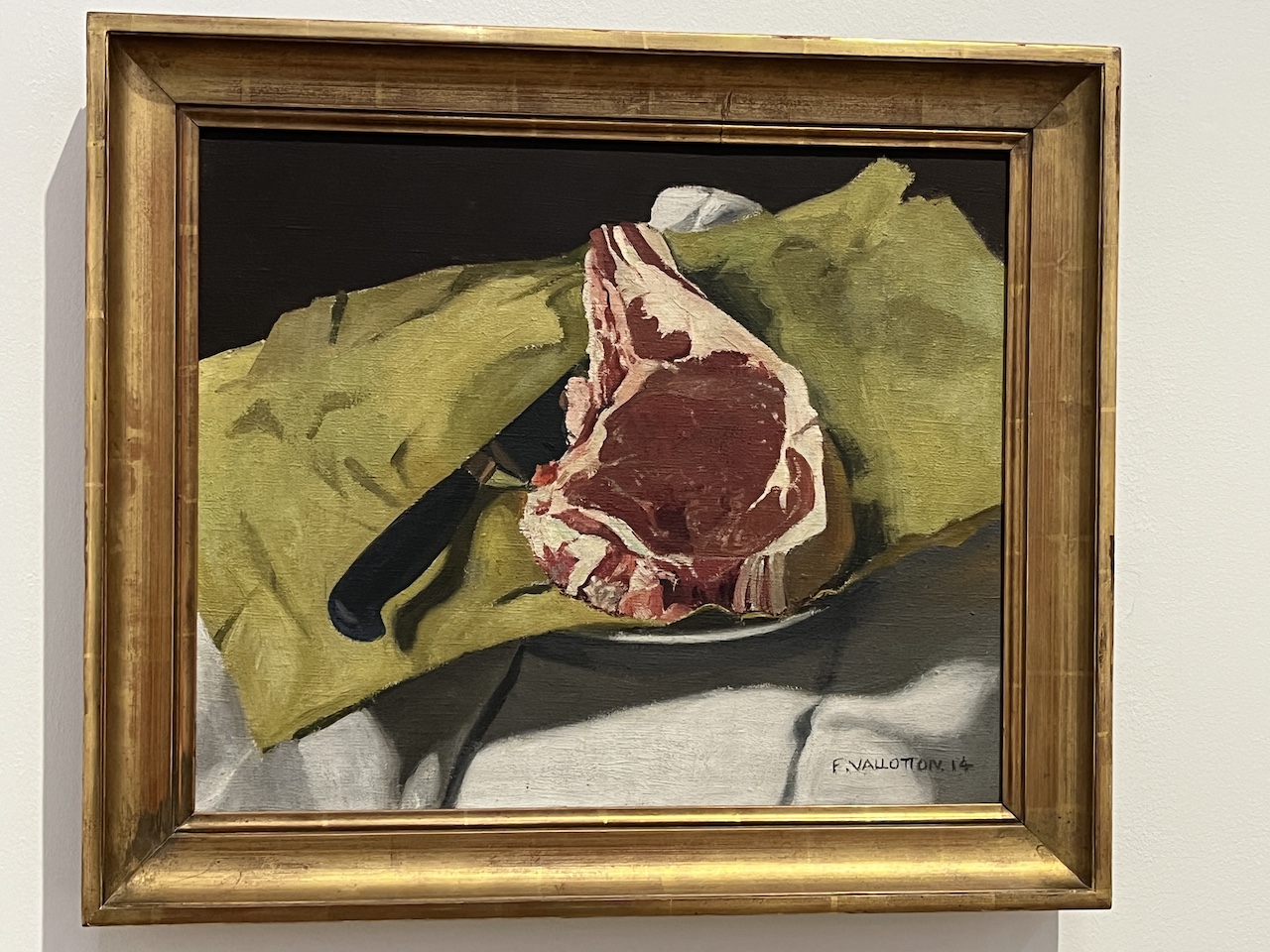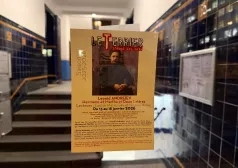J’ai déjà eu l’occasion de présenter Erik Boulatov, qui a fêté ses 80 ans il y a trois ans, mais continue de travailler activement et d’exposer. Je vais donc rappeller simplement que le succès n’est pas venu immédiatement à ce diplômé de l’Institut d’art V.I. Sourikov, à Moscou. Pendant de nombreuses années, il a gagné sa vie à la maison d’édition « Malich », en illustrant des livres pour enfants en excellente compagnie – avec Ilia Kabakov et Oleg Vassiliev.
Ses œuvres ont été présentées pour la première fois dans une exposition collective à Moscou en 1957, et il a dû attendre encore 31 ans pour une exposition personnelle. Mais le succès est tout de même arrivé, y compris financier : Boulatov est l’un des artistes russes contemporains les plus chers, et ses œuvres se vendent aux enchères pour des millions de dollars.
Bien que, depuis 1992, Erik Vladimirovitch vive principalement à Paris avec son épouse Natacha, il continue de se considérer comme un artiste russe et se rend régulièrement à Moscou, où deux rétrospectives lui ont récemment été consacrées : en 2014 au Manège et en 2015 au Garage.
J’ai eu le bonheur de pouvoir converser avec Erik Boulatov après le vernissage de son exposition genevoise actuelle.
Erik Vladimirovitch, vos admirateurs s’inquiètent : pourquoi si peu de tableaux, seulement 260 pour tout ce long parcours créatif ?
Je serais très heureux si je pouvais travailler plus vite. Mais je n’y arrive pas, simplement parce que je ne parviens pas à faire tout de suite ce que je veux, ce qui est nécessaire. Le travail commence lorsqu’une image surgit – dans la conscience ou dans le subconscient, en tout cas je la vois clairement. Et lorsque j’essaie de la matérialiser, cela ne marche pas. Rarement quelque chose réussit immédiatement. Je dois chercher longtemps comment exprimer ce que je veux transmettre. En général, je fais beaucoup de dessins préparatoires dans lesquels je cherche la conception de l’image, car directement dans la toile – c’est une souffrance terrible. Et dans les petits dessins, ça va plus vite, même s’il faut en faire beaucoup jusqu’au moment où je vois : voilà, ça y est, je reconnais ! À ce moment-là, je peux commencer la grande toile. D’ailleurs, les grands tableaux, je les peins assez vite. Donc si je n’en fais pas davantage, ce n’est pas parce que je ne fais rien… Je fais de mon mieux !

Personne n’en doute ! Et merci pour ce que vous avez déjà fait et pour ce qui nous attend encore. La Suisse est liée à votre parcours par des relations anciennes et particulières : c’est ici, plus précisément à Zurich, qu’a eu lieu en 1988 votre première exposition personnelle, qui a lancé votre carrière internationale. Dans les collections suisses – musées (Bâle, Berne) et collections privées (Berne, Bâle, Genève, Zurich) – il y a beaucoup plus de vos œuvres que dans tout l’espace de l’ex-URSS. Quand on prononce « Suisse » devant vous, quelle image apparaît immédiatement ?
La Suisse… (il réfléchit) Je ne sais pas… C’est ma seconde patrie, je suis très reconnaissant à ce pays et j’y viens toujours avec un sentiment très chaleureux.
Et n’avez-vous pas envie de peindre quelque chose de « suisse » ?
J’ai même essayé, j’ai été extrêmement impressionné par le lac Léman, la vue depuis Lausanne, ces cygnes, les montagnes… Une telle beauté ! Mais cela n’a pas marché…
Peut-être faut-il venir plus souvent ? Se promener davantage le long du lac ?
Sans doute (il sourit). Mais si l’on parle de l’image de la Suisse, c’est probablement justement le lac et les montagnes.
Malgré votre amour pour la Suisse, vous préférez vivre à Paris, contrairement à de nombreuses personnalités russes, célèbres à divers degrés, qui ont choisi le pays alpin…
Nous n’avons jamais pensé rester en Suisse, nous étions simplement venus travailler, ce n’était pas une émigration. Et personne ne nous a invités à rester. On nous invitait en Allemagne, en France, mais nous avons d’abord choisi New York, où nous avons vécu un an et demi, puis il est devenu évident que notre place était en Europe – notre mentalité est européenne, et l’Amérique était quelque chose d’étranger. Alors Paris nous a semblé la ville la plus appropriée.

Les artistes russes à Paris est une tradition en soit…
Oui, bien sûr ! (rit) Les artistes russes ont toujours aspiré à Paris, et moi aussi j’en rêvais depuis l’enfance.
Vous êtes une illustration vivante pour ainsi dire de la célèbre phrase selon laquelle « nul n’est prophète en son pays ». Dans votre patrie, on vous a reconnu, compris (ceux qui vous ont compris) et apprécié très tardivement, bien plus tard qu’en Occident. Comme votre cas est loin d’être unique, on peut parler d’un phénomène. Comment expliquez-vous cette « particularité de la mentalité soviéto-russe » ?
Oh, je ne sais pas… Je ne suis pas sûr que ce soit un phénomène purement russe, c’est plutôt quelque chose de propre aux gens en général et qui se manifeste aussi dans d’autres cultures nationales. Cela doit être lié d’une manière ou d’une autre aux particularités culturelles nationales, mais je n’y ai jamais vraiment réfléchi. Pour ce qui me concerne, bien sûr, c’était la faute du système soviétique, et non russe, de l’idéologie soviétique.
Vous en voulez à quelqu’un ?
Non, à quoi bon en vouloir ? J’étais prêt à ne jamais pouvoir montrer ce que je faisais, à ne jamais pouvoir en vivre. Ce qui est arrivé a donc été simplement un cadeau du destin, une sorte de bonheur… Je vois cela comme une deuxième vie : la première s’est achevée, une seconde a commencé.
Ces dernières années, vous allez en Russie comme un invité d’honneur, comme un trésor national. À votre avis, s’agit-il vraiment d’une « nouvelle Russie », ou bien n’a-t-on changé que les enseignes en laissant l’essentiel inchangé ?
On ne peut pas dire qu’on a seulement changé les enseignes et laissé exactement la même chose. Tant que les frontières sont ouvertes, tant que nous pouvons voyager librement, cela n’a plus rien à voir avec le système soviétique. En général, ceux qui parlent ainsi ne l’ont pas connu. Et moi, je me souviens encore des dernières années de Staline. Ceux qui ne savent pas ce qu’était cette époque peuvent encore nourrir des illusions et conserver de tendres souvenirs du système soviétique ; moi, je n’en ai aucun. Il existe un danger de nationalisme, une menace de retour en arrière, et c’est très désagréable. Mais comme je l’ai déjà dit, tant que les frontières sont ouvertes, il n’y aura pas de retour au système soviétique. D’un autre côté, ma dernière exposition au Manège m’a montré à quel point les jeunes ont besoin d’art, à quel point ils s’y intéressent ! Pour moi, ce fut une véritable fête, je ne m’y attendais absolument pas. De jeunes artistes venaient, de simples visiteurs – ils s’approchaient, posaient des questions, demandaient de donner une conférence, écoutaient attentivement. J’étais tout simplement stupéfait !
On entend beaucoup de discours sceptiques affirmant que les jeunes ne s’intéressent à rien, que l’art est fini… Ce n’est pas vrai ! Je comprends que beaucoup ne s’y intéressent peut-être pas, mais beaucoup d’autres – oui, et je l’ai vu de mes propres yeux.

Cela donne de l’espoir, n’est-ce pas ?
Bien sûr, car ils sont notre avenir ; grâce à eux, je ne peux pas partager entièrement le regard sceptique sur ce qui se passe aujourd’hui en Russie. Oui, la situation est difficile, le sentiment que le pays est entouré d’ennemis crée un besoin de se rallier autour du gouvernement, quel qu’il soit. Cela nourrit, sur fond d’hostilité extérieure, la montée d’un nationalisme intérieur, le plus mauvais, le plus soviétique. Je considère que l’attitude de l’Europe envers la Russie est une très grande erreur. Ce sont justement les contacts, la communication maximale, qui peuvent changer la conscience des gens pour le mieux, stimuler le développement de la démocratie, etc. Et repousser la Russie provoque une réaction naturelle en retour. Le danger réside précisément là.
Vous souvenez-vous de l’épisode où les « défenseurs des sentiments des croyants » ont fait irruption dans l’exposition au Manège pour commencer à la saccager ? Comment interpréter cela ?
Je considère que la position de l’Église est en général très désagréable, elle joue un rôle très néfaste dans la culture. L’État ne doit pas intervenir dans de telles affaires, et lorsque cela arrive, cela brouille complètement les cartes. D’un côté, un artiste ne doit pas se permettre des gestes qui offensent véritablement les sentiments des croyants – c’est ma conviction profonde. S’il n’aime pas le comportement de l’Église, il peut exprimer son opinion en trouvant une forme appropriée. Mais la religion, la foi – ce sont des questions dont on ne peut pas se moquer. En principe, si un créateur veut dire quelque chose dans cette situation complexe et aiguë, il doit agir précisément en artiste, c’est-à-dire trouver une forme artistique, une image qui exprime ses pensées et ses sentiments. Dans l’art visuel, l’image est primaire, et le mot, l’interprétation, toujours secondaire. Et si l’artiste agit comme citoyen, comme simple personne vivant dans ce pays et ayant le droit de s’exprimer, il doit comprendre qu’il devra assumer toute la responsabilité civile. Et ne pas crier ensuite qu’on lui bâillonne la bouche, ne pas se cacher derrière l’art. Un acte citoyen doit rester un acte citoyen et être perçu comme tel.

Mais où est la limite ? Nous connaissons tous la formule classique : « tu peux ne pas être poète, mais tu dois être citoyen ». Que faire lorsque tout est mêlé ? Quelle frontière ne doit-on pas franchir en exprimant sa position civique à travers l’art ?
Quand un artiste exprime sa position à travers l’art, cela devient de l’art. Mais lorsqu’il réalise un acte, une action appelée « œuvre d’art », c’est autre chose. Oui, la frontière est complexe, ambiguë, mais elle existe forcément, et l’artiste ne peut pas ne pas en être conscient. En règle générale, ces situations controversées surgissent parce que de jeunes artistes veulent attirer l’attention par tous les moyens. Le moyen le plus direct et le plus simple, c’est le scandale. En sachant parfaitement qu’il y aura un scandale, la personne organise une action sous couvert d’œuvre d’art. C’est malhonnête, et la responsabilité de l’artiste est alors très sérieuse. Bien sûr, l’État ne doit pas s’ingérer dans les affaires de l’art, mais il ne faut pas non plus le provoquer intentionnellement, sinon la faute devient équivalente.
Dans ce cas, lorsque cet artiste se fait poursuivre, condamner, voire emprisonner, il faut bien sûr le défendre, même si on n’en a pas envie. Mais il le faut. C’est précisément pour cela que l’artiste n’a pas le droit de créer de telles situations.
Suivez-vous les jeunes artistes russes ? Trouvez-vous parfois quelque chose qui retient votre attention ?
Bien sûr, il y a beaucoup de choses intéressantes. J’ai des sympathies et des antipathies, comme il se doit. Je suis en contact avec certains jeunes artistes et je regrette que mes séjours trop courts en Russie ne me permettent pas toujours d’élargir ces contacts. En général, la vie culturelle en Russie est aujourd’hui plus intéressante qu’à Paris, par exemple.
Avez-vous eu le temps de visiter la retentissante exposition de Serov au Krymski Val ?
Oui, j’ai eu le temps, trois fois même. Une exposition remarquable ! Et voici un exemple clair du besoin d’art en Russie : des heures d’attente dans un froid glacial…

Malgré votre rejet de tout ce qui est soviétique, dans un certain sens vos œuvres sont un monument à cette époque, ne serait-ce qu’en raison de l’image du « signe de qualité » soviétique. Pourquoi ? Cela ne s’oublie pas ?
Toutes ces œuvres ont été réalisées à l’époque soviétique, et depuis, je ne suis jamais revenu aux motifs soviétiques. Je pense qu’il ne faut pas le faire. Je ne me suis jamais adonné à l’esthétisation de cette époque ; j’ai simplement essayé de l’exprimer. Le fait que mes œuvres vivent et produisent un effet signifie seulement que j’ai réussi à l’exprimer, à le saisir. Et si le temps est arrêté, alors c’est pour toujours. Si un tableau est achevé, il a fixé le temps, lui a donné un nom. Et si cela n’est pas fait, le temps partira sans être reconnu, comme cela est arrivé avec nos années 1990. Et pourtant, quelle époque unique, inattendue ! Cela n’était jamais arrivé avant, et n’arrivera plus. Et les jeunes artistes de ces années-là, qui étaient obligés de saisir le moment, me disaient : « Bien sûr, c’était facile pour vous à l’époque soviétique, tout était clair ! » Qu’est-ce qui était clair ?! Au contraire, il était très difficile d’oser dire quelque chose de personnel, dans son propre langage. Ne pas avoir honte de soi ; mais nous avions honte, nous pensions que tout ce qui était authentique se trouvait soit dans le passé, soit à l’étranger, et que chez nous, rien n’allait – ni la langue, ni la culture. Le véritable artiste ne doit pas prêter attention à cela, il doit regarder vers l’éternité.
Vous êtes devenu célèbre pour vos grandes œuvres graphiques, mais récemment, de nouveaux sujets sont apparus dans votre travail : des fleurs, des paysages. Y a-t-il une explication ?
Je travaille avec le matériau que me donne la vie. Et la vie change.

Donc vous vous êtes récemment mis à remarquer les fleurs et les petits ponts auxquels vous ne prêtiez pas attention avant, lorsque vous créiez des paysages sociaux, pour ainsi dire, et leur donniez des titres comme « Attention ! », « Ne pas s’adosser » ?
Peut-être. J’ai toujours eu envie de peindre un paysage russe tout simple. Et je n’y arrivais pas. Et maintenant, ce n’est pas encore tout à fait réussi, mais j’essaie. En revanche, je crois que mon « Cour moscovite » moderne est réussi. J’adore « La cour moscovite » de Polenov – c’est un tableau absolument charmant, où Moscou est représentée comme un village. Moi, j’ai représenté une cour tout à fait différente – avec des immeubles modernes, des voitures. La cour où nous vivons à Moscou. Bien sûr, ce tableau porte un sentiment tout autre que celui que j’avais en peignant « Danger », par exemple, simplement parce que je n’y vois aucun danger. D’un autre côté, j’ai un tableau « Bonne année », où je vois et ai tenté d’exprimer le danger russe et français – « Bonne année ». Il y a ici l’attente d’une sorte d’explosion. L’œuvre a été réalisée à la veille de l’attentat.
Il y a quelques années, je travaillais sur la toile « Notre temps est venu », où j’essayais d’exprimer la situation russe actuelle, le passage d’une époque à une autre. Ainsi, d’une certaine manière, je poursuis ma ligne, mais peut-être différemment.
En observant attentivement vos tableaux, j’ai souvent eu l’impression que vous peignez en regardant en arrière, mais en étant tendu vers l’avenir. Quel est votre rapport au temps dans notre époque de l’instantanéité, vous qui avez vécu une longue vie où tant de choses ont changé ?
C’est probablement l’âge qui parle. Prenez, par exemple, la toile « Où ». Comment puis-je savoir – où ? Je ne sais pas, personne ne sait. Mais je suis absolument convaincu que là-bas, au-delà de l’horizon, quelque chose existe, que la mort ne met pas fin à tout, qu’autre chose s’ouvre, et que cette nouveauté deviendra essentielle.
PS : Le 13 mai 2016, au Centre Georges-Pompidou à Paris, Erik Vladimirovitch Boulatov receva l’insigne correspondant au titre de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, décerné par le Ministère français de la Culture.